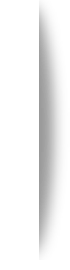De la culture, de la nature et de la digestion (extrait n°9 du 12 septembre 2007)
"L’atelier du peintre" révèle bien des surprises… Dans chacun de ses recoins, il y a des questionnements. Pour "Plic Ploc", chaque goutte d’eau, chaque chanson de la rivière me plongeait dans mon sujet. Pour "L’atelier du peintre", hormis les désirs de création, toujours présents dans tous les sens, je me tape l’histoire et les andouilleries de l’art contemporain.
Jamais le chant simple d’une rivière, mais les phrases en latin de Kiefer sur une plaque de tôle qui ont une prétention à me parler de nature…
Alors… Lisons, apprenons.
Je lis une conversation entre Beuys, Kounellis, Kiefer et Cucchi en 1984, à la Kunsthall de Bâle ("Bâtissons une cathédrale", éd. de l’Arche.) : ces artistes déplorent la mort de la bourgeoisie après la guerre et l’avènement d’une classe qui n’a pas de morale, ils regrettent une perte de niveau et ils cherchent une centralité à l’œuvre et à l’artiste. Ils semblent avoir peur des artistes plus jeunes qu’eux.
Bon… lisons, apprenons.
Je vais voir des expos, j’en parle et cela fait débat dans la compagnie, car il y a toujours la tentation universitaire de prudence : celui qui ne sait pas tout ne peut rien dire ! Je regarde, je ne sais rien et je dis. Je veux placer ma réflexion à l’endroit où je suis, pas ailleurs. La liberté est celle-là : regarder de l’endroit où nous sommes, apprendre avec humilité, mais ne pas se soumettre aux dogmes d’aujourd’hui. Je vous livre donc mes impressions… "L’atelier du peintre" est en jachère, il se repose. Ce spectacle sera fertile de toutes ces fumures.
Culture.
Je rentre de vacances, une semaine passée chez mes amis dans la presqu’île guérandaise.
Alors, bien sûr, je suis allé à Saint-Nazaire. Cette ville possède dans son cœur un bunker immense, la base des sous-marins allemands qui ne fut pas détruite par les bombardements.
À Saint-Nazaire, les Allemands ont résisté du 4 août 44 au 11 mai 45, dans une poche dite "la poche de Saint-Nazaire", la reddition des troupes allemandes ne s’étant faite qu’à la capitulation de l’Allemagne nazie.
Saint-Nazaire possède aujourd’hui, dans ce lieu malfaisant, noir et inquiétant, un lieu culturel à l’ambition illimitée appelé "Le LIFE" (Lieu International des Formes Émergentes, je vous "prille" de respecter les majuscules !). Les créateurs du nom de ce lieu ont dû turbiner sec pour trouver le nom, j’imagine qu’ils n’ont pas réussi à en trouver un plus… enfin, moins… enfin… pas tant… heu…, alors ils ont gardé celui-là.
Donc, j’y suis été, comme on dit dans ma campagne.
Dans ce Lieu International des Formes Émergentes, il y avait une exposition émergeante. Une immense affiche annonçait en majuscules impressionnantes : "Edwin Van der Heide : absolute psychedelic". Rien que le nom, ça fout les jetons… Et puis, "ça le fait", façon "La Fabrique" de Warhol ou lieu alternatif berlinois d’avant la chute du mur : il n’y avait donc pas à hésiter ! Nous étions dans le Lieu International des Formes Émergentes (en américain : la soumission à la langue de l’Empire signale l’émergence… Au train où va le monde, on ne va pas tarder à parler et écrire chinois, chez les émergents !).
L’expo : dans un hall noir et long du bunker, au son d’une bande qui boume-boume, il y avait une démonstration d’effets laser dans un petit brouillard d’eau pulvérisée, c’est-à-dire 2 ou 3 lasers qui croisaient leurs fils de lumière, bleus ou verts, en faisant les effets prévus dans le catalogue, tels qu’on peut en voir chez les marchands de lasers, dans les boîtes de nuit, au "cirque Flic Flac" en Allemagne et bientôt chez l’épicier chinois au coin de votre rue pour attirer les clients. Les silhouettes des spectateurs se détachaient du brouillard comme dans une toile de Fromanger… Joli effet…
Et voilà ! Quoi d’autre ? Ben… rien ! Rien qu’une démonstration démodée d’un engin technique, un effet forain qui attire le chaland, comme au Futuroscope de Poitiers : une démonstration technologique sans idées, sans poésie, sans rien. Mais dotée d’un discours au scalpel, d’une affiche immense conforme, et d’une scénographie encore plus conforme à l’idée qu’on se fait de l’émergence depuis une vingtaine d’années.
Bref, ça m’a méchamment gonflé !
Mais tout de même, un coup de colère, ça ne suffit pas : qu’est-ce qui me gonfle autant dans cette histoire ?
C’est que les créateurs de ce genre de choses prévoient et bétonnent tout avant de créer l’œuvre, même le discours, l’effet obligatoire et ce que le public doit en penser. Ils nous ligotent et le spectateur n’a plus aucune liberté. C’est un art qui peut être qualifié de totalitaire dans sa prétention à imposer un modèle, à nous soumettre à ce modèle, à sacrifier à des modèles.
Quand Royal De Luxe pose un géant dans une ville, il offre ce géant à la ville, mais, surtout, il offre la liberté d’imaginer ce qu’on veut du géant. C’est un art formidable, car il est modeste, dans le sens où le commentaire ne précède pas l’œuvre : c’est un art vivant, qui nous permet d’espérer notre liberté d’agir sur le monde.
Par contre, par sa communication pour cette expo, le LIFE nous oblige à penser et à adhérer à sa seule vision officielle. Sans le pompeux prétentieux, cet entresort forain aurait pu ouvrir une liberté et même devenir - allez pourquoi pas, soyons pas chien ! - une œuvre d’art. Mais c’est raté !
Pour "L’atelier du peintre", j’ai cherché à utiliser les effets de laser, de fils de lumière… Mais je n’ai pas réussi à trouver autre chose que la pauvre idée de faire des effets techniques dans du brouillard humide. J’ai donc abandonné, pour l’instant. Raté avant de commencer… C’est plus simple, ça m’évitera de m’engueuler !
Et si j’y reviens, tant mieux, c’est qu’on aura trouvé quelque chose.
Nature.
Entre Nantes et Saint-Nazaire, au fil de l’estuaire, il y a une exposition d’œuvres contemporaines : Jean-Luc Courcoult, de Royal De Luxe, a créé la réplique d’une maison d’un village qu’il a posée au milieu de la Loire, à demi immergée. Cette œuvre, dont la photo fut largement diffusée dans les magazines, consacrait ce créateur de spectacles de rue comme plasticien contemporain.
La Loire en crue a englouti la maison avant l’inauguration. Ce sont les géants qui l’ont coulée.
Pour la poésie et la liberté.
Je me suis carapaté dans le marais d’Assérac, où, avec des amis, nous avons observé vendredi 31 août, entre 15 et 17 heures, entre autres oiseaux réguliers des lieux humides, une grande aigrette et une cigogne noire. Je sais, tu t’en fous, mais ça fait rudement plaisir : il y a 20 ans, j’avais observé dans le même coin une première cigogne noire et j’avais signalé cette observation à la Ligue de Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique. J’étais le sixième à signaler cet oiseau à cet endroit, espèce dont certains individus étaient en train de changer de route migratoire. Les oiseaux ont une histoire, et nous pouvons l’observer de notre vivant. C’est chic !
Digestion.
"France Cul", dans la voiture qui me ramenait vers le Jura, citait Deleuze au cours d’une émission consacrée à la Bêtise - et donc à la connaissance. Il disait qu’il y avait des personnes qui, pour connaître, reconnaissaient. Leurs connaissances étaient constituées de reconnaissances, et en ce qui le concernait, disait-il, sa connaissance était plutôt une digestion.
Deleuze disait connaître par digestion. Cette idée m’a frappé. Et je me reconnais dans ce concept de digestion, de connaissance digérée.
Le spectacle procède quelquefois de ces notions : il est des spectacles qui sont faits de reconnaissances, et nous reconnaissons ce que nous venons voir. D’autres sont le résultat d’une digestion.
Nous avalons en vrac la connaissance, d’ici, de là, et clic-clac, l’ensemble devient molécules, sang, sperme, larmes, désirs, idées, merde, éclairs de plaisir, pointe de douleur, nouveauté, rabâchage, instants magiques et uniques, longue litanie de déjà vu, incroyables moments mélangés à de prévisibles tableaux… Notre connaissance des arts est ainsi digérée dans la création d’un spectacle. Bien digérée, mal digérée, mais digérée.
Ensuite, et à cette seule condition, nous pouvons travailler sans avoir peur d’être la reconnaissance d’une connaissance apprise dans une encyclopédie, lue dans un magazine de mode, dans Art Press ou étudiée dans un article branché d’une revue de cirque contemporain. La parodie n’a pas sa place, les références y sont priées de se faire discrètes et la symbolique légère.
Digérées, nos connaissances ne font plus dictature et nous pouvons créer.
Culture, nature et digestion.
En gestation de "L’atelier du peintre", je redeviens élève et me remets à la connaissance des arts plastiques (d’où la teneur actuelle de ce carnet) : l’histoire, les œuvres et, hélas, les commentaires. Il y a 30 ans, j’étais un fan de peinture, et puis j’ai abandonné cette voie-là pour me consacrer au spectacle, aussi parce que, à l’époque et dans la configuration psychologique et sociale qui était la mienne, je me suis interdit de m’inscrire aux Beaux-Arts. J’en crevais d’envie, mais je n’ai pas pu le faire, je ne me sentais pas à la hauteur. Je pense aujourd’hui que c’est socialement que l’interdiction était formulée (comme je n’aurais pas pu non plus étudier ni au conservatoire, ni dans une quelconque institution). Certains ont classé ces sortes d’empêchements dans la catégorie des "névroses de classe"… J’ai tout de même étudié quelques mois l’histoire de l’art à Besançon : je me souviens des enseignements sur "le rouge dans la peinture de Delacroix" au moyen de vieilles diapositives en noir et blanc projetées sur un mur !
Bref, je renoue. Continuons la visite de l’art contemporain : allons au musée.
Le Musée des Beaux-Arts de Besançon est un formidable musée, je crois que ce fut le premier créé en France. C’est également à Besançon que l’architecte Claude-Nicolas Ledoux a créé le premier théâtre moderne. Il y a plein d’autres choses incroyables de ce style à Besançon, mais je ne vais pas vous bassiner avec, l’Office municipal du tourisme ne m’a toujours pas envoyé mon chèque ce mois-ci…
Nous sommes allés, Brigitte et moi, au musée de Besançon visiter une exposition de dessins du XXème siècle. En voici l’annonce :
Invention et transgression, le dessin au XXème siècle.
L’exposition présente une sélection de plus de 135 dessins majeurs issus du Cabinet d’art graphique du Centre Pompidou national d’art moderne. De Picasso à Sylvia Bächli en passant par Max Ernst, Henri Matisse, Louise Bourgeois ou Raymond Hains, l’exposition réunit aussi bien des oeuvres historiques faisant référence aux grands mouvements artistiques du XXème siècle que celles d’artistes contemporains encore peu connus qui contribuent à la diversité et au renouvellement du dessin.
Que du beau monde !
Plein de dessins. Majeurs. Attention ! Majeurs, les dessins. Des gribouillis en tous genres. Bien digérée, la connaissance du dessin au XXème siècle, et rendue telle que nous le présente cette exposition. Si bien digérée qu’on peut dire l’effet de toute cette digestion sur le visiteur, en l’occurrence votre serviteur : C’est chiant ! Mais alors chiant !
Je ne me prononcerai pas plus, de peur de n’en parler que par reconnaissance, de par mon inculture et mes méconnaissances.
Chaque œuvre d’art m’interroge sur le référent qui procéda à sa création : autrefois, pendant des siècles, le référent a été la nature, la divinité de la nature, Dieu, le créateur, la beauté également dans ce qu’elle nous rapprochait des divinités et de notre essence divine opposée à notre essence bestiale. Le référent était aussi l’envie de connaître, d’ajouter à la connaissance universelle.
Cette référence n’est plus de mise dans l’art d’aujourd’hui : il n’y a plus de peintre dans l’atelier du peintre. Il n’y a plus qu’une absence de peintre.
À cette exposition, je m’interrogeais sur les référents qui conduisirent les artistes et les créateurs de l’expo à proposer ces œuvres.
Il m’apparaissait que ces dessins avaient l’Homme, voire son nombril, comme unique référent. La prétention de cet ensemble était dans ce qu’on considérait le moindre geste de dessin sur une feuille comme une œuvre d’art.
L’ensemble des dessins présentés dans l’exposition me paraissait si pauvre, si laid, si morose, si chiant à regarder (excusez-moi pour la répétition) qu’il m’apparût comme formant une immense négation, une préparation au nihilisme de nos temps modernes : pensant aux oeuvres qui ont précédé les dessins "inventifs et transgressifs" de cette exposition et constatant que, dans celle-ci, il n’apparaissait aucun artiste figuratif, je compris que toute cette exposition de dessins "inventifs et transgressifs" était à la gloire de l’égotisme humain. À la gloire de la domination de l’homme sur toutes choses, vivantes et mortes.
Je me suis dit que cette exposition était la méthodique préparation du public à la destruction de la planète.
C’est beaucoup, me direz-vous… Et pourquoi pas ?
Plus (pas) de beauté, plus de nature, plus de référent à la vie, à la connaissance de la vie : cette exposition "inventive et transgressive" nous parlait de mort, ces oeuvres (et le baratin qui va avec) accompagnaient une mortelle idéologie de la négation du vivant. Lorsque l’art n’est plus qu’une référence de et à l’art, de et aux idées qu’on professe sur l’art, l’art s’enferme dans un jeu de miroirs, dans un mortel palais des glaces où son image se duplique à l’infini.
D’où la question : Le traitement d’une importante partie de l’art contemporain reconnu n’est-il qu’un "teasing" destiné à nous préparer à la mort du monde vivant, à la destruction de la diversité, à l’accompagnement d’une idéologie industrielle et urbaine de conquête absolue et de destruction par l’homme de tout le vivant qui ne sert pas ses intérêts immédiats (sans parler du vivant qui lui fait peur !) ? Aujourd’hui, vis-à-vis de la destruction de la planète, quel art est l’équivalent d’un Pablo Picasso de Guernica et lequel celui d’un Arno Brecker (sculpteur officiel du troisième Reich) de notre époque ? C’est sérieux ! Quelle(s) référence(s) pour l’art d’aujourd’hui ?
Aragon disait (in "Chronique de la pluie et du beau temps") à propos des suites du procès Dada du langage :
"Le mécanisme inversé de la parole humaine qui part des mots au lieu de partir des choses est admis et admiré comme en d’autre temps la règle des trois unités, ou tout autre pont-aux-ânes esthétique. Il est à la base du nouvel académisme, aussi tyrannique que l’ancien, qui a fait de la réalité son ennemie, comme tout académisme."
C’est plutôt ça que je voulais dire, merci Loulou.
Dans la suite de ce genre de réflexions sur l’art, Ariane Mnouchkine disait ceci dans "Le Monde" du 18 juillet dernier :
"Q : C’est important de pouvoir pleurer au théâtre ?
Oui. De pouvoir rire, aussi. C’est un long débat que celui de ce rapport entre l’émotion et les idées, l’abstraction. Je pense que le théâtre n’a rien à gagner à être abstrait. Quand des acteurs et un public se rassemblent, s’il n’y a pas un peu d’émotion, un échange, à quoi bon être là ?
Q : Que répondez-vous à ceux qui pensent que cette émotion bloque la réflexion ?
Je leur dis merde. Pas un peintre, pas un romancier, pas un poète, pas un sculpteur d’importance ne s’est posé la question en ces termes. C’est une fausse question. Que ces intellectuels autoproclamés passent d’abord par l’émotion, et après on verra si les idées tiennent."
Vive l’art et la poésie (et les géants).
Je vous embrasse.
Bernard Kudlak