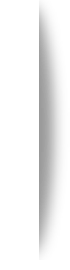Le journal de New York (juillet 2001)
New York, le 7 juillet 2001
Deux cents tonnes de ferraille sur le parvis du théâtre. les mats se montent.
Le parking du dessous tremble, le montage amuse les gratte-ciel tout autour.
Deux cents tonnes de ferraille pour tenir une plume. Plume posée, sur l’asphalte de New York city.
Aucune pince (pas de piquet) quand deux cents tonnes de plaques de fer plaquent, plaquent, d’une main de fer... la toile, le chapiteau, la tente du cirque plume.
New York city en Amérique.
Nous allons nous envoler, notre loriot jaune s’est posé sur la place tranquille d’un théâtre ordinaire dans un coin d’une ville extraordinaire.
Ils ont posé des coussins bleus sur nos bancs de bois. Nous allons commencer les répétitions. Dans les rues et dans Central Park -qui est leur petit bois- des femmes, de taille moyenne, bronzées, musclées, toutes habillées du même short, et d’un Marcel sur leurs petites épaules musclées, courent. Elle courent d’un pas court et musclé. Toutes courent du même pas.
Toutes tiennent dans la main, un boîtier, qui est relié à leur tête, par des fils. Vous ne pouvez pas les manquer surtout le dimanche, et hier c’était dimanche. Nous sommes passé par le park pour rejoindre le chapiteau. La, on en a vu plein.
On s’est demandé si ce n’était pas des modèle d’humaines bio technologique qui tiennent leur disque dur dans la main pour pouvoir courir !
Pour le reste, c’est assez cool, presque la campagne, ici !
Les gens sont habillés comme dans leur cuisine et les femmes aussi.
Tout le monde parle avec la voix de Donald Duck !! Il y a une très grande courtoisie et gentillesse. Dans la rue des gens gentils. Ah c’est pas Paris !
Qu’est ce qui vous marque le plus à deux jours des représentations ?
Pour pouvoir jouer en Amérique, il faut obéir au syndicat. Et la ça rigole pas ; même la CGT du livre, en France, fait office d’enfant de coeur devant la puissance bornée du syndicat. Pour chaque technicien français il faut embaucher un technicien américain. Dès qu’on allume une lampe de service, il faut deux techniciens américains et comme un technicien américain ne peut pas travailler sans chef, il faut aussi embaucher deux chefs. Je ne sais pas si il faut un chef pour ces deux chefs, je vais demander à Jean Marie (notre directeur technique) et je vous le dirai . Nous avons pu négocier que des artistes s’entraînent pour eux même, et sans matos pendant la pause du repas. A condition qu’il n’y ait pas de musique car si il y a de la musique, il faut deux ou trois techniciens, avec... les chefs ! Et comme c’est l’heure du repas tous seront en heures supplémentaires. Ca te la coupe Blondel ? On est venu voir comment fonctionnait le libéralisme, dont l’Amérique nous propose chaque jour le modèle, on en apprend tous les jours.
Dans l’ascenseur qui nous monte en deux secondes au quarantième étage, il y a un téléviseur qui passe des cartoons.
That’s all folks.
Bernard Kudlak
New York, le 10 juillet 2001
Quand on voyage, on en apprend tout les jours.
Hier encore je n’aurai pas cru qu’il puisse exister autant de modèles différents de pieds de biche.
Je vous explique.
Les américains quand il font les choses ils ne les font pas à moitié. Pour notre plaisir peut être ou peut être pas, il y a eu une alerte au feu dans un bâtiment de la 57eme rue, on arrivait juste à ce moment la. Alors là, la totale, les camions rutilants qui font un bruit du diable afin que tous soient informés que les vaillants pompiers de la ville de New York City veillent sur la sécurité de tous. Ah les beaux pompiers. Ils sont sûrement habillés par un costumier de Broadway j’imagine, un costumier de talent. Vraiment des costumes épatants. Ce sont les derniers gladiateurs. À la ceinture, ils portent la hache et diverses armes pour combattre le feu et une armada impressionnante de pieds de biche de toutes les sortes. Un combattant du feu manie le pied de biche à ouvrir les portes par le bas, un autre celui qui les découpent comme une boite à sardine, son collègue , un géant, possède le pied de biche pour ouvrir les portes par le haut. Et plein d’autres instruments dont je n’ai pas la moindre idée d’usage. C’est vrai qu’hier quand nous sommes entrés à l’hôtel, la fausse alerte était éventée, alors les pompiers erraient dans le hall, comme des musiciens de fanfare dans le square, après le concert . Des camions de collègues à eux pas prévenus que l’alerte était fausse, continuaient à débarquer dans un fantastique son de klaxon et lumières de gyrophares. De demi tours furibards.
Le demi tour furibard, c’est chouettement impressionnant.
C’était réussi ! Entre nous je ne crois pas vraiment qu’ils ont fait ça pour nous. Mais c’est tombé sur notre hôtel. J’espère que ce n’est pas une répétition et que la prochaine fois ça n’arrivera pas pour de vrai. Surtout qu’il y a une piscine sur le toit de l’hôtel, je nous vois mal tout les clients de l’hôtel dans la piscine en attendant les pompiers...Comme c’est un hôtel chic, tous les mecs tiendraient leur attaché caisse ou leur sac à ordinateur sur leurs têtes. Et les cravates qui flotteraient comme des lombrics dans une flaque d’eau.
Même quand il n’y a pas de feu, il fait chaud ici. Non seulement le soleil chauffe mais de grand soupiraux qui traversent le trottoirs nous inondent les mollets de courants d’air brûlants. En été à New York, ils chauffent dehors. J’aurais pas cru !
C’est incroyable le nombre de trucs que j’aurais pas crus avant de venir ici.
Aujourd’hui dans l’ascenseur, c’était charlot à l’armée. Bon c’est la première ce soir, tout est prêt, la non plus j’aurais pas cru !
Bernard Kudlak
New York, le 13 juillet 2001
Comme on est à New York et pour faire plaisir à Dominique- notre directeur administratif, j’avais prévu de vous parler de la Chapelle-sur-Furieuse. C’est un petit village du Jura en France où nous habitons ma famille et moi même. Il s’y est passé deux événements notables il y a quelques années.
Le premier c’est une bataille incroyable du temps des mérovingiens.
Mais Jacques Schneider et Fanny Soriano, deux de nos artistes, se sont chacun blessés à la fin de la première du spectacle à New York. Alors la bataille, on verra plus loin. Jacques s’est scratché à la réception du saut périlleux qu’il exécute -et le mot n’est pas trop fort- à bicyclette sur un trampoline. Son pied droit a quitté le "cale-pompe" pendant le saut, exactement quand il a la tête en bas, et bling !! L’ensemble ange/bicyclette en plein vol nous a donné l’impression de vouloir franchir la barrière de toile du trampoline. Alors les Burgondes, les Wisigoths, et autres Ostrogoths de la Bataille de la Chapelle-sur-Furieuse dans le Jura Français, vous pensez bien que je dois les mettre sous le paillasson.
En parlant de paillasson, la vue de l’ange rétamé sur trampoline vous fait une boule au ventre comme si vous aviez avalé une serpillière. Surtout que les secondes qui suivent la chute organisent une surface de douleur autour de Jacques : on la sent irradier du corps de l’ange, puis devenir volume de douleur à la dimension du cadre noir.
Le public n’a rien vu ! Il a cru que c’était fait exprès, que le Wisigoth ailé qui repart en boitant est une créative idée, la remémoration de la chute de l’ange, façon modeste. Et bien sûr, c’est aussi bien ainsi. Du temps où on labourait à la Chapelle-sur-Furieuse le moindre carré de terre pour manger, dans le terrain appelé "Champ de la bataille", on retrouvait encore bien des pointes de flèches.
Mais aujourd’hui on ne le laboure plus, il y a des génisses, c’est la paix des "pâtis" semés d’animaux. Là où j’ai rien vu, mais rien de rien, quelques secondes avant la chute de Jacques - en plus il est alsacien, l’Ostrogoth ! - c’est quand Fanny, "Petite Perfection" dans le spectacle, s’est fait attaquer par le vélo qu’elle tient au dessus du trampo, accrochée qu’elle est dans les nœuds savants de sa corde.
Vous voyez ça ? Un trampoline, au dessus duquel pend un pendule constitué de Fanny pendue à une corde, tenant un vélo que Jacques vient de lui passer avant d’aller chercher celui qui lui servira à faire le saut périlleux sur trampoline (qu’il est le seul à effectuer au monde, on se demande pourquoi !)... Vous suivez ? Bon ! A ce moment là, personne n’a rien vu !!
Le vélo, ce traître, ce félon, profitant peut être que personne ne regarde, happe la main de Fanny entre la chaîne et les dents du pignon. Et les fukings dents du pignon lui bouffent un morceau du majeur comme un vulgaire requin blanc de film catastrophe américain dans les fesses de la blondasse de service !!
Quelques secondes après cette attaque surprise du vélo contre Fanny - son Pearl Harbor à elle - Jacques se ramasse en beauté (voir plus haut...) ! Deux zéro la balle au centre !
Excusez de parler de ma petite personne, mais je fonce en coulisse pour voir Jacques et je tombe - le mot est-il bien choisi ?- sur Fanny qui tient sa main en sang. Merde Bleue !
Jacques est par terre, crispé de douleur, et deux femmes - Isabelle qui est infirmière et Fabienne une amie kiné - à genoux autour de ses jambes, lui vaporisent du froid avec des bombes prévues pour, sur le tibia touché.
J’ai de la semoule dans la tête et Jacques blessé me dit ce que j’aurais dû penser : "prends le manteau et fait l’ange à ma place pour la fin du spectacle !"
Dont acte ! Je monte tout en haut de la structure, me ramasse un peu dans les escaliers tout noirs et je domine la salle du plus haut de la scène. Ange noir pétri de trac. Je passe les quelques dizaines de secondes de la fin du spectacle à faire descendre l’ange en moi pour le donner à la salle. Et je sens cela. Six ans que je n’étais pas monté sur scène... Le deuxième événement ne s’est pas exactement passé à la Chapelle-sur-Furieuse, mais à Paris, à la Bastille. Nous avons dû annuler une représentation et répéter comme des fous. Fanny et Jacques ont attendu cinq heures aux urgences de l’hôpital accompagnés par Séverine et Brigitte (deux autres artistes) pendant que nous, on buvait du champagne et mangeait des petits fours dans la "Party" d’ouverture du festival.
Cinq heures pour rien ou presque... l’infirmier a lavé le doigt de Fanny à l’eau froide, et un autre a conseillé à Jacques d’aller voir un médecin le lendemain afin qu’il lui prescrive une I.R.M.
Le lendemain, cent dollars la consultation du médecin.
Les blessures ne sont pas graves, mais gênantes et douloureuses. Nous jouerons ce vendredi, un spectacle adapté, mais possible. Nous avons annulé jeudi la deuxième représentation prévue. Pendant la prise de la Bastille, il y avait deux drapeaux qui flottaient sur la prison, un des deux a été dérobé par un gaillard de la Chapelle-sur-Furieuse qui en fit don aux citoyens méritants de la république de la ville de Salins-les-Bains. Le drapeau a disparu au cours du 19ème siècle ! La planète Mars (c’est marrant comme de dire "la planète Mars" adoucit le côté guerrier attaché à elle... mais foin de la bataille c’est tout pour aujourd’hui), donc Mars est dans notre ciel le soir, quand on lève la tête, elle (il ?) apparaît au milieu des gratte-ciels. Des fois, je me demande à quoi pensait l’homme qui, en cet endroit aujourd’hui appelé Manhattan, regardait les étoiles pendant qu’à la Chapelle-sur-Furieuse se déroulait la bataille au lieu-dit "Champs de la bataille"….. Avec toutes ces émotions et l’angoisse de la suite et du rétablissement des blessés, je ne me suis même pas aperçu que la première représentation était un succès ! C’est tout pour aujourd’hui, Ca me fait vraiment plaisir de vous parler de New York chaque jour.
A bientôt !!
Bernard Kudlak
New York, le 14 juillet 2001
Allonzenfants !!! j’ai vu ce matin un drapeau français sur la hampe improvisée d’un antenne de liaison radio sur un énorme 4X4 garé près du Whitney Muséum !
Nous sommes allé au cirque ce matin de fête nationale. Au cirque de Calder.
Papy Calder bricole un petit cirque comme n’importe quel retraité de la Haute-Marne et joue de ce cirque devant un public. Une vidéo nous montre cette représentation. C’est très sympa. Ce côté bricolage met le musée à la hauteur des activités ludiques, ça nous repose des installations.
En parlant de cirque, peut être puis-je parler un peu du notre. Donc à la première, deux blessés et la deuxième annulée. Ca commençait sur les chapeaux de roues. Nous avons répété une nouvelle version en essayant de garder le sens. Je pense que nous avons pas trop mal réussi.
Je me suis aperçu que le stress de la première et des jours qui ont suivi m’ont totalement masqué le fait que le spectacle a été vraiment apprécié. Cependant les spectateurs de la seconde représentation était beaucoup plus expansifs, chaleureux, moins guindés que pour la première. Jacques et Fanny se rétablissent bien. Encore qu’on ne puisse pas savoir si nous ferons le spectacle en entier au moins une fois ici. J’espère que nous pourrons. Je me souviens de Phil Glass. Il accompagnait nos rêves Baudelairiens, dans les chemins voluptueux et assommés des paysages créés dans les volutes de fumée de l’herbe à nigaud.
Il est a présent un grand compositeur américain reconnu. Nous sommes allé voir "Le corbeau blanc", un opéra dont il a écrit la musique, mis en scène par Bob Wilson. Une commande du Portugal pour célébrer le cinq centième anniversaire des grands voyages portugais autour de la terre.
Chouette musique ; et belle mise en scène très formelle. Il y a une forme moderne des gestes rituels de l’opéra, c’est étrange. Le plateau m’évoquait souvent le peintre surréaliste Tanguy. Nous avons été touchés par la force et la simplicité de la musique. Robert Miny était content.
Les portugais sont allés partout, même en Inde, mais les taxis à Lisbonne conduisent comme des fous. Aujourd’hui, en sortant du musée, on a pris un "cab" conduit par un indien qui conduisait comme un portugais. Dans une street transversale, il a entamé une course avec un bus qui ne voulait pas céder la place. Il a gagné. N’empêche que Bob Wilson dans le début des année soixante dix , quand on écoutait -pétés- Phil Glass, il nous avait épaté : dans la troupe de théâtre amateur dont je faisais partie, on avait essayé de faire tout lentement comme lui. On a pas tenu longtemps ! Lui il continue et c’est rudement beau ! Des fois, l’art, quand on en parle, ça gonfle, des fois ça gonfle même si on en parle pas. La vie semble tellement fragile qu’on aimerait que l’art l’accompagne comme un pampre de liseron sur une branche d’églantine au mois de juin. Faut que j’arrête, le béton me rend bucolique. J’ai l’impression qu’il y a un truc dont mes amis New-Yorkais essaient de me parler depuis que je suis ici, c’est la vitesse de cette ville, son énergie, son dynamisme, sa folie, etc….. Quand t’es touriste dans la rue, tu le vois pas, tu vois juste des gens en short ! On dit qu’il y a un syndrome de la distribution des prix : faut avoir le prix d’excellence, paraît-il, ici. A tout prix ! C’est ce qu’on dit, mais j’ai rien vu encore de tout ça. Je ne regarde peut-être pas dans la bonne direction. Il y a peut être un musée pour tout ça ! Dès que je le vois, je vous préviens.
A plus tard.
Bernard Kudlak
New York, le 15 juillet 2001

- A droite, Dominique notre régisseur artificier, affublé de son homologue américain syndicalement obligatoire
Sans me vanter, les conditions sonores dans lesquelles on travaille sont totalement déplorables. Je dis "sans me vanter" parce que ça me fait penser à Woody Allen. C’est curieux comment on connaît tout de New York sans y être jamais allé. J’imagine que bientôt on aura l’impression de tout connaître sur tout sans jamais l’avoir appris. Ça promet !!
Pour le confort des américains, il a fallu installer une climatisation dans le chapiteau. D’habitude ici, en été, le climat est très chaud et humide, insupportable. Pas pour nous, cet été, c’est juste la bonne température. Il ne manquerait plus que le réchauffement de la planète profite à New York en particulier. Enfin la ville est à la bonne température à l’extérieur, et un peu glacée à l’intérieur du chapiteau.
La ville à l’intérieur, parce que dans le chapiteau, on est plus chez nous, on est à l’intérieur de la grosse machine, du plus grand centre culturel du monde. En bref, le générateur d’air polaire fait un bruit de tous les diables à quelque pas de la toile du chapiteau. Dans les moments du spectacle où nous ne jouons pas de musique, la qualité de silence est la même que celle que l’on a dans un Boeing en vitesse de croisière. Paradoxe du chapiteau ! On adore le chapiteau et on aime encore plus les vrais silences. D’autant que le générateur est situé coté jardin, sur la rue, qui nous informe immédiatement du passage des ambulances, de la police ou des pompiers.
Coté cour il n’y a pas de rue, donc il n’y a pas de passage bruyant d’automobiles ou de corps civiques. En revanche, coté cour, il y a une cour et dans la cour coté cour, il y a chaque soir un cour de danses populaires au son d’un orchestre qui commence sa musique à peu près en plein milieu de notre spectacle. La qualité de non- silence est alors à son comble. Bol, hier c’était du swing et ils ont baissé la sono. Le spectacle n’a pas été gêné.
Lundi, c’est l’orchestre de musique cubaine qui revient et il va falloir négocier serré.
Dans la cour coté cour, elle court elle court la musique. Ça nous laisse un peu court pour entendre le souffle des artistes. Espérons qu’on entendra leur âme, ça fera moins de bruit. Et alors ? Le spectacle marche très bien dans la version sans le trampoline. Particulièrement hier, les artistes ont intégré l’ensemble du spectacle, comme il est aujourd’hui, et cela s’est traduit par de subtils déplacements d’énergie. Tout était réellement à la bonne place.
A part le fait que notre show est à la place des cornichons dans un sandwich de décibels, le reste marche bien. Le bruit est sûrement un facteur habituel dans ce patelin.
On va pas gueuler, on a voulu venir, on y est !
La cour où jouent ces orchestres qui nous cassent les burnes et les oreilles chaque soir est dessinée par les façades des trois grandes salles d’opéra du Lincoln Center : le "Métropolitain Opéra", le "Avery Fischer Hall" et le "New York State Théâtre". Par les fenêtres du Métropolitain Opéra, on voit deux immenses toiles de Chagall.
C’est très émouvant.
Chagall nous a donné envie de faire du cirque……
Atchao à demain.
Bernard Kudlak
New York, le 16 juillet 2001
Aujourd’hui, Central Park.
En fait on y est allé hier. Mais aujourd’hui aussi, en vrai, on y va tous les jours, on est pas sérieux quand on a quarante sept ans et qu’il y a des tilleuls sur la promenade….
Hier nous sommes allés voir une amie bisontine qui vit là depuis le siècle dernier. Elle nous a présenté Chuck, Buck, Dick, Nick, Bill, Bob des jeunes gens bien bâtis, bronzés, et deux demoiselles dont je ne sais pas le prénom, sympathiques, la trentaine sans enfants. Tous champions de freesbee acrobatique. Nous avons assisté à une partie qui se déroulait sur une très grande pelouse de piscine, tous le monde était en tenue de bain, à se bronzer au soleil. Il ne manquait que la piscine ! Et des enfants ! Quasi pas de mômes, sur cette pelouse du dimanche- fin de l’après midi.
Vla qu’une des jeunes filles pousse un cri. Affalée dans son transat de voyage, elle épluche le New York Times, je pense qu’elle a commencé tôt le matin, parce que elle avait presque tout épluché, vu les pelures de journal qui traînaient autour d’elle (le dimanche c’est deux kilos de New York Times ! tu vois la corvée !). Toujours est-il qu’elle appelle notre amie :
![]() Kiki ! it’s you in this photo ? (Kiki est-ce toi sur cette photo ?)
Kiki ! it’s you in this photo ? (Kiki est-ce toi sur cette photo ?)
![]() Yeah ! with Piotr, Nanard, Jean-Marie. (il y manquait, Alain, Robert, Serge, Christophe et les autres, il n’y avait pas non plus nos dames et demoiselles)
Yeah ! with Piotr, Nanard, Jean-Marie. (il y manquait, Alain, Robert, Serge, Christophe et les autres, il n’y avait pas non plus nos dames et demoiselles)
Voilà qui nous rapprochait sérieusement des champions de freesbee de Central Park : nous étions en photo dans le carnet mondain du New York Times. Nous avions été photographiés à la party de l’ouverture du festival -pendant que nos ami(e)s vérifiaient l’état des urgences de la ville de New York- par un photographe totalement déconnant qui vous fonçait dessus avec son appareil, pour pouvoir prendre votre tête après l’effet de surprise ! Lui aussi est un champion. Je n’avais jamais autant fréquenté de champions !! Quand je vais dire ça à mon boucher ! Un truc qui m’a scié : les bancs de bois de Central Park ! Les dossiers des bancs de bois de Central Park .
Rivetées au dossier de beaucoup de bancs de bois vert, des petites plaques de métal nous appellent au souvenir de personnes disparues. Par exemple vous vous appuyez sur un dossier, vous vous reposez sur : "À la mémoire de mon père Robert John Machinchouettsky 1907-1992 et son épouse Maryline 1912-1989. Ils aimaient à venir se promener ici !". C’est un exemple !
T’as l’impression de t’asseoir sur une tombe.
Passée cette première impression, on pense aux stèles qui parcouraient les routes de Grèce avec leurs petites épitaphes émouvantes, pour les passants : "Passant, si tu vas à Sparte….".
Une autre -je cite de mémoire- (elle est traduite du grecque par Marguerite Yourcenar, l’écrivaine que je suis son fan !) : "Ci-gît machin qui n’eut pas d’enfant, et regretta toute sa vie que son père n’en fit pas autant !"
À Central Park, c’est des petits mots de mémoire plus gentils.
Et là, j’ai compris : ce sont des gens qui se sont réincarnés en banc de bois ! Non je déconne ! ne me faites pas de procès ! Pitié, c’est pour de rire !
N’empêche que moi, j’aimerais bien être réincarné en banc de bois à Central Park, ou ailleurs.
La nuit, les clochards viendraient prendre leur sommeil sur moi, ils m’offriraient un parfum de l’humanité que je viens de quitter.
Mais le jour ! Ah le jour ! De jolies dames aux fesses molles dans leurs robes de taffetas rose, viendraient tendrement déposer leur féminité, dans une fragrance de violette ou de réséda !
Ah !! les collections de derrières….
Je sais ne pas pouvoir espérer les jeunes derrières musclés et vigoureux des sportives et modernes New Yorkaises.
Je me consolerais en me disant que je ne suis pas de marbre, moi le banc de bois encore vert. Et par ailleurs, régulièrement repeint. Je les regarderais, les demoiselles de la grosse pomme, quand elles courent. Toujours, elles courent, et quand elle ne courent pas, elle s’étirent dans le gazon.
Moi, j’aurai tout le temps, et je les attendrai, jusqu’au jour où elles ne courent plus. Alors, elles viendront vers moi, posant leur fesses et le réséda, sur ma surface lissée par les frottements. Chaque jour, nos petits rendez-vous, puis elles ne viendraient plus, elle ne viendra plus, un beau matin sans elle…et plus de journées….plus d’elle…..
Plus tard encore, un amour, un amant, plus tard, beaucoup plus tard , un fils, pourquoi pas, viendrait visser dans le bois de mon dossier, une plaque : " Dans ce parc, elle fut beaucoup aimée ". Mais, jamais il ne pourra savoir par qui, réellement par qui, elle fut tant aimée.
Ainsi irait mon éternité de banc de bois amoureux des femmes, jusqu’à la fin du temps des bancs de bois……
Le plus rigolo ce serait qu’une d’entre elle se réincarne dans le banc de bois d’à côté du mien, pour y attendre les messieurs de la grosse pomme.
Toute une éternité d’amour et de rigolade !
Je vous embrasse.
Bernard Kudlak
New York, le 17 juillet 2001
Le quinze juillet tombait un dimanche, il y a deux jours. Je crois que les quatorze et quinze (en France, le 14 juillet est le jour de la fête nationale), il se passait quelque chose à l’ambassade de France, mais nous étions invités à une "party", à Brooklyn. Une "party", c’est une réunion entre amis, pour manger et faire la fête.
Je me souviens des surprises-parties : La partie c’était pour danser sur les yéyés ou les Beatles, et la surprise c’est quand t’approchais pour la première fois ta cavalière, elle faisait semblant de pas voir ton corps chercher le sien, mine de rien, et tout d’un coup tu sens ses petits seins durs contre ta poitrine. Il y en a fallu des "Hey Jude" pour arriver là. C’est là que Bling !! la surprise de la partie, 258 000 volts dans le fond du caleçon. T’as beau pas être surpris, t’es étonné de jusqu’où ça va ! C’est bien simple, une fois la surprise partie, il te reste jusqu’au bout de la fin de tes jours pour t’en remettre !
Là c’était une party, mais la surprise n’avait rien à voir. C’était une petite surprise. Quoiqu’il traîne toujours un peu de cette érosélectricité quand, dans une fête, se croisent des messieurs et des dames (malgré que nous soyons dans un pays dont on dit -ça ne se voit pas tant- qu’on y a fait des lois en bakélite pour protéger les mâles des femelles de ces phénomènes incontrôlés).
La petite surprise… avant, il faut que je vous dise que nous étions invités à un barbecue. Comme il n’y a pas de jardin, nous avons été le faire sur le toit de l’immeuble.
Et là, la petite surprise ! D’ailleurs, le garçon qui devait allumer le feu n’a rien trouvé de mieux que de mettre le feu au charbon en l’arrosant de pétrole. Nous avons grillé le poisson et le bœuf dans une bonne odeur de kerdane qui nous rappelait le temps où nous crachions le feu, tout en conversant sur les risques de cancer que pouvaient causer les molécules aromatiques et autres benzènes cachés dans le flacon.
Le soleil se couchait sur la ville. Nous dominions Manhattan qui au loin s’allumait de soleil et d’éclairage artificiel. Attention : Man Ha ttan. Il faut expirer violemment le h aspiré pour prononcer le mot correctement ! Pour les ricaneurs du fond de la classe, le h aspiré, c’est pas de la propagande, j’ai arrêté de fumer il y a déjà vingt trois ans !! Donc une soirée à regarder une ville, très belle de loin, au milieu des nuages rougis de soleil, et au milieu de tout ça, la petite surprise : bien en vue, l’empailleur state building , le roi des grattes ciels, s’était maquillé de lumière bleue au dernier étage, blanc à l’avant dernier, et rouge en dessous, en l’honneur de la fête nationale française, et peut être même -comment savoir- en l’honneur de la révolution de 89. Nous avons apprécié cette élégance ! Quand on va dans le monde, on y est bien accueilli !!
On est parti tard, après la surprise passée, après une bonne soirée. Quand on prend le métro à New York, on sent combien on apprécie le collectif dans ces contrées. Pas besoin d’avoir le nez fin ! Des métros, on en a déjà pris, vu le métier qu’on fait. Celui de la ville de Wall Street (qui serait cousin à Walt Disney par la gauche !) est plutôt vieux, moche, vétuste, bruyant, qui vous secoue comme prune, et pas sale. Il n’y a plus de graffitis, ils se sont barrés : le métro est tellement naze, qu’ils ont retraversé l’Atlantique dans l’autre sens. Il y en a même eu un sur le camion de mon frère ! En parlant de migration, je suis allé voir l’exposition de Salgado appelée "migrations".
Le métro te secoue à l’extérieur, les photos de ce mec te remuent à fond l’intérieur.
La claque comme d’habitude. Notamment une Piéta : en Afrique, un homme malade agonise dans les bras d’une femme. La tête de l’homme repose sur la cuisse d’une autre femme debout, dont on ne voit que le bas du corps vêtu d’une grande robe de toile, ou d’un boubou. Sur cette étoffe, un motif décoratif construit une auréole autour de la tête de l’homme qui agonise. Le Christ est vivant, il agonise chaque jour en Afrique. Et tout le reste est de cette force.
Cette expo suscite un débat dans la presse : peut-on faire du beau avec l’extrême malheur de l’humanité ? Je n’en sais rien, mais quand on voit le travail de ce photographe, on voit qu’on peut produire l’extrême malheur avec de la belle richesse d’une petite partie de l’humanité.
L’expo était dans la sixième avenue, pour rentrer, je suis remonté et au 1301, il y a le building du Crédit Lyonnais. Un super gratte-ciel d’au moins plein d’étages, j’ai voulu compter, mais t’as qu’à voir, c’est pas simple. Enfin, de le voir, j’en conçus un sentiment patriotique de solidarité. Vu que les nullards qui ont dirigé cette boite nous ont tous arnaqués de quatre mille balles par contribuable, quand on voit écrit en lettre d’or "Crédit Lyonnais Building" sur un immeuble aussi haut que les américains, on calcule ! Dans la troupe, on vient à trente deux : à tous, ça fait cent vingt huit mille balles qu’on leur a filées. Avec ça ils ont dû pouvoir au moins acheter une lettre en or, pour décorer le gratte ciel.
Ceci dit, il faut reconnaître que grâce à eux -le Crédit Lyonnais- on est pas dépaysé. Ils nous ont bien rendu service, d’un certain côté : la bourse, tous ces trucs, avant on comprenait rien au système. Maintenant grâce au Crédit Lyonnais, on sait que c’est tout simple : quand ils perdent des ronds, c’est nous qu’on paye, quand ils en gagnent, c’est eux qui ramassent.
Alors, il n’y a plus qu’a être tous actionnaires ! Salgado t’as pas fini de faire des photos ! Et au revoir à bientôt. PS : C’est un hasard, mais au moment de livrer cette missive, je tombe sur un article du journal Libération daté du mardi 17/07, qui dit que 1% des plus riches de la planète possèdent les richesses cumulées des 57% plus pauvres.
Bernard Kudlak
New York, le 18 juillet 2001
Je vous écris du spectacle, derrière le chapiteau après la magie pour ceux qui connaissent. Encadré par les générateurs d’électricité et d’air froid qui nous moulinent tranquilles nos soixante quatre décibels journaliers (seuil inférieur absolu du silence, ici). Vous avez compris que ça me chagrine. Et bien oui ça me chagrine, mais j’ai des éléments d’informations supplémentaires : le générateur émet un mi-bémol, mais un peu plus aigu que le monocorde qui joue pendant le numéro de fil (la note qu’émet l’archet frotté à cette unique corde est aussi un mib), le tango sonore entre les deux mib désaccordés crée des battements de fréquence.
C’est pas pour rien que Bob à été accordeur de piano dans une vie précédente. Je savais que cela allait vous intéresser.
Normalement il faudrait que je vous parle du spectacle, mais je vais vous dire, nous avons fait du tourisme avec ma petite famille. Du tourisme à l’entresol !!
Comme dans plein de villes où se croise le monde entier, il existe une visite de New York dans des espèces de bateaux-mouches à roulettes, des bus à deux étages dont l’étage du dessus est sans toit (t’imagines mal que celui du dessous n’en ait pas non plus !). Donc on fait le tour d’une partie de la ville entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et c’est rudement intéressant comme moyen de locomotion pour visiter le paradis des architectes qu’est cette ville insensée. Parce que ce n’est pas d’avoir fait toutes les rues perpendiculaires et parallèles qui va lui donner un sens précis.
Ce fut une révélation : je crois, grâce à ce bus mouche, avoir compris la quintessence du tourisme. Qui dit mieux ? Un truc marrant, si tu te lèves dans le bus, tu risques de te prendre les feux tricolores du dessus, en pleine poire. Mais enfin, les gens dans le bus, c’est pas le genre à se lever si c’est pas permis.
Comment c’est permis aussi de parler du spectacle ?
Qu’est ce que tu crois que je peux raconter sur le spectacle ! A ma place ? Bon d’accord, j’en parle pas dans ma rubrique ! Et pour cause : on peut guère être dedans et dehors. Non ? Si, j’ai un truc à dire : on a eu une deuxième critique dans le New York Times, elle est excellente. Ca me fait plaisir ! Et une super aussi dans Daily News.
![]() Quoi ? une critique, c’est pas le spectacle !
Quoi ? une critique, c’est pas le spectacle !
Je te dis, j’arrive pas à écrire sur le spectacle ! Ils n’ont qu’à venir le voir, le spectacle. Un spectacle, c’est une histoire d’amour, d’amitié, de tendresse, un spectacle ça se vit du dedans, du dehors, ça se vit comme on est avec ceux là, les ceux qui vous proposent le voyage. Je ne me sens pas de faire le tour-opérateur de Plume à New York.
Justement à ce propos, il y a un malentendu consternant le tourisme. D’abord, d’aucuns affirment "voyager", pas "faire du tourisme". Parce que dans la tête de plein de monde que je connais, il y a une différence entre les deux, voyager c’est bien c’est l’aventure, faire du tourisme c’est mal, c’est le conformisme moutonnier. En vrai, on s’en fout !
En revanche, si on croit que les gens (ceux qui peuvent, ça partage déjà) le font pour rencontrer la vraie vie des autres, la partager, ou si on croit qu’on voyage pour ça (partager la vie des indigènes dans un temps limité, de la nôtre, de vie), on se fout le doigt dans l’oeil. C’est exactement le contraire. On voyage pour ne pas être dans la vie des autres !
On fait du tourisme pour, enfin, ne pas être dans la vie de tous ces autres qui nous emmerdent avec leurs soucis, qui sont les nôtres. On peut toujours ricaner des japonais qui en troupeau dans les traîne couillons - du style de ce dont je vous parlais - nous photographient. Ils sont dans le vrai acte poétique, créatif, à savoir : ménager un temps de leur vie hors du monde, surtout hors du monde. Comme quand on voyage dans un train, on est personne ! Dans un train, notre vie est libre, entre deux mondes, entre deux gares, pas d’obligations, pas de standing à tenir, libre et rivé sur deux rails entre le réel et le réel.
Le tourisme c’est ça, regarder les autres et ne pas en être. Entre deux mondes, sans contingence. Un parfum de vacuité.
L’esprit libre, regarder les fourmis qui s’agitent, sans souci de sa propre fourmilière.
Abandon de sa dignité, de son stress, de son rang ? Certainement. Puis le train entre dans la gare, alors avec ses bagages, on reprend sa vie sous le bras, allégé, soulagé de quelques heures d’absence. A ce propos l’usage des portables dans le train est un crime contre la poésie du présent. Une soumission à l’ordre du réel qui impose jusque dans nos têtes sa dictature. Reiner Maria Rilke si tu savais !…Les touristes se repassent les photos de leurs vacances, pas pour les paysages qu’ils ont photographiés - surtout qu’on les voit pas tant que ça les paysages, Janine et Marcel ont pris du poids - pas pour ça, mais pour retrouver une nostalgie de la vacance de leur vie, quelques instants ou quelques jours où ils ont eu le droit tarifé de ne pas être comme tout le monde au milieu de tout le monde…….
Voilà une découverte qui me rapproche de mes congénères !
![]() Pratique ! Et le spectacle ?
Pratique ! Et le spectacle ?
![]() Lequel ? Celui d’hier, de demain, d’il y a un an ? Un spectacle n’existe que dans l’acte, pas autrement ! (je vais encore me faire bien voir !)
Lequel ? Celui d’hier, de demain, d’il y a un an ? Un spectacle n’existe que dans l’acte, pas autrement ! (je vais encore me faire bien voir !)
Et surtout, un spectacle, ça se fait à deux, comme l’amour, ensemble, c’est une relation entre un public et une troupe, ce jour-là ! T’entends ? : ce jour-là !
Demain c’en est une autre, avec d’autres gens, donc un autre spectacle.
![]() Si j’exagère ? Pas du tout, t’as qu’à venir, tu verras. En plus, venant de moi, qui ai participé à l’élaboration du spectacle, son alchimie, j’arriverai pas à vous raconter quoique ce soit, sans avoir envie de me vanter. Me vanter, parce que, autrement, on a trop peur de mettre du doute dans la tête des "à qui on raconte". Et quand on a du doute dans les godasses, ça fait trop mal aux pieds de l’âme. Écoutez ! Les représentations, ici à Nouillorque, ça marche vachement bien, et même que ce soir (mercredi) le spectacle est joué en entier, nos blessés sont réparés.
Si j’exagère ? Pas du tout, t’as qu’à venir, tu verras. En plus, venant de moi, qui ai participé à l’élaboration du spectacle, son alchimie, j’arriverai pas à vous raconter quoique ce soit, sans avoir envie de me vanter. Me vanter, parce que, autrement, on a trop peur de mettre du doute dans la tête des "à qui on raconte". Et quand on a du doute dans les godasses, ça fait trop mal aux pieds de l’âme. Écoutez ! Les représentations, ici à Nouillorque, ça marche vachement bien, et même que ce soir (mercredi) le spectacle est joué en entier, nos blessés sont réparés.
Tu vas pas me dire, on fait un drôle de job ! Il y a une semaine le moral était dans les chaussettes avec les cailloux du doute de tout à l’heure dans les godasses, et aujourd’hui, ça baigne.
Faut dire qu’une annulation de spectacle, ça vous met mal. C’est une sorte d’infidélité qu’on assume pas très bien. C’est sensible ces petites bêtes-la ! C’est comme pour la critique. Dix bonnes critiques font plaisir, on ose à peine en boire la pleine coupe, une mauvaise vous bouffe le foie. C’est un lieu commun mais c’est comme ça ! Même si on est fervent des sceptiques, du bouddhisme ou autres taoïsmes de la paix du vide. En parlant de sceptique, je me suis fait une réflexion, vous vous souvenez de cette célèbre phrase de Montaigne : "Vérité ici, mensonge de l’autre coté des montagnes". Ben elle est devenue quoi la vérité maintenant qu’on a supprimé les montagnes ? Et le mensonge ?
Je vais garder ça pour demain, je crains d’avoir été un peu long.
C’est déjà bientôt la fin de notre séjour ici, je vais pouvoir aller faire du tourisme.
Je vous embrasse. (je deviens familier, mais à force, on crée des liens !)
Bernard Kudlak
New York, le 21 juillet 2001
Ben voila c’est le dernier jour pour le texte, demain je prends le train ! (en fait, ce texte se trouve être l’avant-dernier de ces chroniques new-Yorkaises). Le train ici c’est des heures de queue pour prendre le billet et un mec qui écrit au stylo tous les renseignements sur une liasse de billets composés de plein de feuilles de papier carbone. Quand il a fini d’écrire, il tamponne chaque feuille dupliquée. Il te donne ton billet puis range les autres feuillets, le rose, le vert, le bleu, chacun dans sa petite pile de la même couleur qu’il lie avec un élastique. C’est moderne mais presque.
Ça m’a mis de bonne humeur, malgré les deux fois trente minutes de file d’attente vu que je m’étais trompé de gare !
Les "monteurs" sont arrivés pour démonter notre chapiteau, en forme et tout bronzés pour ceux qui sont allés dans le sud.
Ils nous amènent des nouvelles du pays (je ne vais pas vous les donner, vous y êtes, et je dois parler de l’Amérique, en plus, vous ne connaissez pas les gens). C’était bien, New York, en définitive. Nous sommes même allés voir la statue de la liberté.
Un cadeau de la France à l’Amérique. Dans l’espoir qu’un jour l’Amérique aide la France à récupérer l’Alsace et la Lorraine.
C’est très beau cette géante aux formes, pour le coup, modernes, et à jamais ! On sent réellement que les émigrants devaient avoir le cœur regonflé d’espoir en accostant sur cette île.
Tu te rends compte, t’arrives des dictatures plus ou moins royales d’Europe, et t’es accueilli par une statue qui dit être la liberté.
C’est sûr que ça doit faire un choc. Dans l’autre sens aussi probablement, j’imagine que bien des pères de famille autoritaires et rigides n’ont pas dû vraiment apprécier ce genre de chose.
Je vous rassure, il n’y a pas de risque : l’Amérique c’est pas la liberté, car dès qu’on définit ce mot, il franchit la frontière, lui aussi.
Pas de soucis, la société américaine est bien encadrée. La liberté s’entend dans une certaine direction à laquelle Calvin et Luther ne sont pas étrangers. Nous l’avons diversement senti.
Par exemple ma petite fille jouait en slip sur la scène, il faisait rudement chaud, la climatisation venait seulement de se mettre en route : une équipe de télé présente m’a demandé qu’elle quitte le plateau ou qu’elle se rhabille, car on ne peut pas filmer une petite fille de six ans qui joue en slip en plein été. Etonnant non ? Ceci dit, un voyage t’apprend au moins une chose : tu es libre de voir ce que tu veux. Dans le cas de ce pays, nous sommes gavés d’images et de visions toutes faites. Nous sommes abreuvés de l’idéologie de ce pays, aussi bien que l’était un paysan chinois de celle du grand timonier.
Presque aussi gavé que de l’idéologie anti. C’est dire ! Parce que tout cela s’additionne et ne s’annule pas.
Alors quand tu débarques quelque part, tu peux vérifier que tout est bien en place, tu trouveras toujours ce qu’on veut absolument te montrer. En bien comme en mal.
En revanche on peut également avoir la liberté d’essayer de ne pas voir le monde à travers les lunettes que l’on a fabriquées pour toi.
Ceci dit, il y a des domaines où ce que tu vois correspond à ce qu’on voulait te montrer. Alors ?
Ce que j’ai senti, c’est l’individualisme total dans cette société, malgré l’extrême courtoisie des gens ici. Et ce n’est pas contradictoire.
On peut penser, après avoir passé dix jours, que la société de la grande ville américaine, est une société au stade oral. Moi et mes besoins, et rien d’autre. Satisfaction des plaisirs du gavage en prime abord. Manger plus, digérer plus, gober plus. Etre plus gros plus grand plus fort. Il y a un aspect grande bouffe de Ferreri dans la société d’ici, allié à une autre idée qui est que si je paie, j’ai droit. C’est simple et efficace. Payer c’est comme brailler pour un bébé, la cuillère de blédine suit immédiatement et on est les rois du monde. J’ai payé j’ai droit ! Misère de misère, on sent ça tellement. J’ai le droit de tout bouffer.
Avaler toute l’énergie, laisser couler le robinet, brûler du pétrole, avoir la température exacte sinon je fais pipi et je me roule dedans. Que le gaspillage est une forme de culture.
Ceci dit, il y a tellement de nature, de richesses naturelles qu’il faut être imaginatif pour penser que tout n’est pas à volonté.
Le pays est tellement grand et relativement peu peuplé que l’idée millénaire que la terre est inépuisable est en vigueur ici plus qu’ailleurs.
Donc plus, plus grand, plus gros, plus bruyant, plus, plus. Et dès que tu sors de là (j’écris à présent depuis le train) la nature est immense et belle, forêts sans fin qui ondulent autour du grand fleuve, et tout semble inhabité.
En un quart d’heure de la ville plus ville que toutes les autres, la sauvagerie sylvestre. New York à la vue de tout cela, c’est le fortin du désert des tartares. Peut-être que dans l’immense cité, un capitaine veille au-dessus de la ville : dans une haute capitainerie, il attend les hordes de païens, ces sauvages que nos cousins, que les frères de nos grands-parents, ont repoussés plus loin, encore plus loin, avec la bible, les fusils, et les fils de fer barbelé, jusqu’au pacifique. Les premiers habitants de ce continent, qui reviendraient avec leur amour de la terre, leurs chants, leurs poèmes. Avec leur paganisme joyeux et aimant des arbres, de l’eau et du vent.
Romantisme d’européen amoureux des livres de Jim Harisson ou de Cormac Mac Carthy ? Probable…..
En réalité on se demande comment les hommes, dans ces immensités, ont fait pour se rencontrer. Espoir des uns, destructions des autres.
L’espoir de trouver un paradis animait ceux qui partaient pour les Amériques. Etre enfin neuf. Ne plus sentir la poussière des siècles sur le revers de son manteau. Une petite forme de l’éternité.
C’est pour cela que l’on sent ici une disponibilité des habitants à ce qui va arriver.
Une disponibilité, une vrai bonne volonté de vous rendre un service, d’être pour un temps disponible.
Et, pour moi une autre chose, positive et essentielle, croire que chacun peut accomplir quelque chose d’utile, de bien, de nouveau, de créatif. Que le développement de chacun profite au bien de tous. Que c’est enfin possible, rendu possible par le neuf. Tu peux le faire, et nous pouvons t’aider à le faire. J’ai tellement souffert de nos impossibilités idéologiques d’entreprendre quoi que ce soit en France, souffert des "pour qui tu te prends !", des "ne trahis pas ta classe sociale !", des "ne fais rien qui puisse changer !", des "tu n’y arriveras jamais !", des "c’est pas pour toi !" et plus encore, toutes les mesquineries méprisantes sur lesquelles se fondent les rapports d’autorité dans notre pays…Entendre un autre discours sur les possibilités de l’humain fait un bien immense.
Dans les pays catholiques, Dieu t’a attribué une place, contente-toi s-en ; malheur aux pauvres, aux mal nés. Dans les pays protestants, Dieu t’a donné la force de développer tes capacités, tes réussites sont une preuve de ta foi ; malheur aux vaincus, aux inadaptés, aux victimes. On n’est peut-être pas obligé de choisir entre les deux non ? Entre être riche, jeune et en bonne santé et pauvre, vieux et malade. On a choisi d’être vivant il y a longtemps ou moins longtemps - ça dépend de notre âge - et déjà ça, faut un sacré bout de temps pour assumer ce choix ! Restons en là ! J’ai beaucoup aimé ce voyage, la terre est belle, mon dieu ce qu’elle est belle. Mais qu’allons nous en faire ? Aujourd’hui, avec ce que l’on a et ce que l’on sait ?
Bernard Kudlak
New York, le 25 juillet 2001
La vraie question est de savoir si je peux continuer, si personne ne me lit … la vraie réponse est que je vais essayer. Re-départ à partir de Westport, par le même et unique train qui relie New York à Montréal. Ligne que nous avions empruntée, ma famille et moi, pour nous rendre de New York à Westport.
Arrêt à la gare à quinze heures dix neuf. Une heure de retard. C’est comme à l’habitude.
Quatre heures pour faire moins de deux cents bornes, douane comprise.
Le train roule lentement, voilà l’explication. Cela nous permet de regarder une biche ici, un hydravion là, sur le lac Champlain. Grand, très grand. Mais tout petit à coté des grands lacs. On est en voyage, pour regarder et échanger.
Ici c’est comme partout, enfin partout où on connaît, aussi paumé que le fin fond de la Haute- Saône, des drapeaux américains sur tous les perrons des habitations de bois. Comme en Scandinavie. Quand tu es si peu de monde dans une si grande contrée, tu as intérêt à affirmer appartenir à une communauté humaine qui en compte plein, des humains. Alors tu mets le drapeau pour te sentir civilisé. Des fois qu’il y ait des doutes. T’en vois toi, des raisons d’avoir des doutes ? Nous sommes un peu secoués. Entre le champ de maïs et le train passe un cimetière, à moins que ce soit le contraire.
Nous avons quitté les montagnes et voici la plaine. Nous avons longé un immense verger de pommiers très jeunes. Le train ne roule pas à cinquante à l’heure.
Le train est en train de se traîner, cela ne devrait pas nous étonner.
Je viens de voir une ferme "Fantasia chez les ploucs" ! Tout y est : les vieux bidons qui traînent, des déchets, deux carcasses d’automobiles affalées dans l’herbe jaune qui furent Cadillac ou autre bateau, un troupeau boueux de bovins, entassé sous une étable grise de planches de bois disjointes.
Je vous l’avais dit qu’on n’avançait pas : j’aime beaucoup ce train international qui va à l’allure du petit train touristique qui monte à la citadelle de Besançon. Et en plus c’est un train pour petit garçon : il klaxonne tout le temps, chaque fois qu’une route, un chemin, une gare, un ours ou que sais-je encore croise le chemin de fer. A peu près tout le temps. Un vrai train qui siffle c’est rare. Ils auraient du garder le charbon et la vapeur, ça marchait aussi bien et les petits garçons auraient été encore plus aux anges. Voilà la frontière, nous sommes arrêtés dans un champ de navets : un douanier féminin au délicieux accent du Québec nous demande de préparer nos papiers.
Après la frontière, nous avons l’explication : les wagons, vieillots mais confortables, datent des années cinquante, la voie est exploitée pour le trafic de marchandises mais ne convient pas réellement pour ce type de wagons. De plus la chaleur a tendance à écarter les rails, donc le convoi roule prudemment. Du reste, quand il lui prend la velléité d’accélérer - le vieux train du nouveau continent - tout tremble au dessus de nous, dans les paniers à bagages.
C’est un voisin, passager qui nous fournit aimablement les informations. Puis nous arrivons à Montréal, par un grand pont sur le fleuve Saint Laurent, le pont Victoria, d’où nous découvrons le pavillon français de l’exposition universelle de 67, qui sert à présent de casino.
Je me souviens de cette expo, car c’est l’année où Mimile, habitant de St Pierre et Miquelon, le bout du monde, est venu, après une visite à l’expo, rendre visite à mes grands-parents qui l’avaient hébergé en 1945, à la libération du pays de Montbéliard. Il était alors soldat de l’armée de Leclerc ou de Delattre de Tassigny, je n’en sais rien. Mais le plus important pour moi est que Mimile m’a évité bien des représailles, quand j’ai passé le conseil de discipline.
Conseil de discipline pour indiscipline, en classe et envers un enseignant névrosé et débile qui baffait et soulevait ses élèves par les oreilles.
Mimile roulait dans sa dauphine de location à la même vitesse que sur son île (qui est la même vitesse que le train New York - Montréal, environ trente kilomètres à l’heure. Très souvent la petite auto sur les routes de Franche-Comté formait la tête d’un long serpent klaxonnant (comme notre antiquitrain !) dont le corps énervé était parcouru de spasmes d’autos qui n’arrivaient pas à le dépasser. "Ben quoi faut pas être pressé !". Sa présence à la maison, et ses tonitruants "Fusillé à l’aube !" à mon endroit, ont détendu l’atmosphère et mon paternel ne pouvait pas raisonnablement user de ses propres représailles pour un conseil de discipline qui tournait à la farce. D’ailleurs la sanction n’a été que quelques heures de colle que j’effectuai dans la classe des troisième - c’était mon année de cinquième - pendant le cours de maths, ce qui m’a fait apprendre ce que l’on appelait les maths modernes avec facilité et trois ans d’avance.
Donc le pavillon de l’expo, devenu un casino, puis les gratte-ciels dans le ciel du soir, les lumières de la ville.
Grand hall de gare des années quarante avec des bas-reliefs à la gloire des bâtisseurs du Canada sur ses faces intérieures à chaque bout de cette grande boîte à chaussures. Ecrit en Anglais et Français pour le Canada et pour le Québec.
Amérique francophone : on peut tout dire, mais ça fait plaisir.
Bernard Kudlak
FIN DE CES "CHRONIQUES NEW YORKAISES".